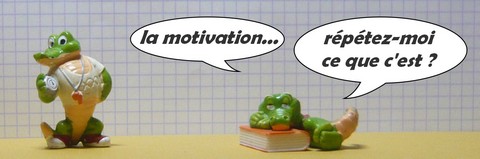Causes de la motivation
La motivation est ce qui nous donne envie de passer à l’action, de continuer nos efforts et de donner du sens à ce qu’on fait. Elle est un lien entre nos besoins, nos désirs et nos actions.
En management comme en psychologie, comprendre la motivation revient à comprendre pourquoi les gens font ce qu’ils font.
Alors si vous êtes motivé pour en savoir davantage, vous découvrirez ici qu’elle dépend de notre biologie, de nos expériences, de nos valeurs, mais aussi de l’environnement social dans lequel nous évoluons : culture, organisation du travail, reconnaissance, rapport à l’autorité…
Définition
Le mot « motivation » vient du latin movere : « mouvoir ». Être motivé, c’est être en mouvement vers un but.
En psychologie, on distingue souvent trois dimensions de la motivation :
- La direction : vers quel but on oriente son action.
- L’intensité : la force de l’effort fourni.
- La persistance : la durée pendant laquelle on maintient cet effort.
Différentes théories ont tenté d’expliquer ce phénomène. On peut les regrouper en deux grandes familles : les théories du contenu (ce qui motive) et celles du processus (comment la motivation se construit et se maintient).
Un peu de biologie…
La motivation ne se limite pas à la psychologie. Elle a aussi une base neurobiologique.
- La dopamine joue un rôle important. C’est le neurotransmetteur du plaisir anticipé. Elle ne récompense pas le plaisir obtenu, mais la poursuite du but. C’est elle qui nous pousse à poursuivre un effort en vue d’une récompense. Trop de dopamine (ou une sensibilité élevée) peut mener à la dépendance et trop peu, à l’apathie ou à la dépression.
- L’adrénaline et la noradrénaline sont liées à l’excitation, à la vigilance et à la mobilisation d’énergie face à un objectif.
- La sérotonine intervient dans la régulation de l’humeur et de la satisfaction. Un niveau équilibré favorise la motivation stable et la persévérance.
- L’ocytocine, dite « hormone du lien social », renforce la motivation à coopérer et à s’engager pour autrui. Elle joue un rôle important dans les contextes d’équipe ou d’entraide.
Ainsi, on peut dire que la motivation naît d’une alchimie entre cerveau et environnement. Un objectif stimulant déclenche une cascade hormonale qui alimente l’effort mais cette dynamique peut s’éteindre si la récompense est perçue comme inatteignable ou injuste.
Causes individuelles : les théories de McGregor et la TAD
L’une des approches les plus célèbres est celle d’Abraham Maslow (1943), avec sa fameuse pyramide des besoins. Selon lui, la motivation dépend de la perception qu’un individu a de ses besoins et de leur satisfaction relative.
Frederick Herzberg, psychologue du travail, a affiné l’approche de Maslow en 1959. Pour lui, supprimer l’insatisfaction n’est pas suffisant pour motiver. Il faut créer des conditions favorables à la satisfaction intrinsèque.
En 1960, Douglas McGregor a proposé une vision managériale très influente avec ses théories X et Y. Il ne s’agit pas de véritables théories au sens expérimental, mais de représentations que les manageurs se font de leurs employés, lesquelles influencent leurs pratiques de gestion.
Selon la théorie X (pessimiste), l’être humain moyen n’aime pas travailler. Il faut donc le contrôler, diriger, sanctionner pour qu’il fournisse l’effort nécessaire. D’ailleurs il préfère être dirigé plutôt que d’assumer des responsabilités. C’est une approche autoritaire et hiérarchique, héritée du taylorisme et du modèle industriel du début du vingtième siècle.
Selon la théorie Y (optimiste), le travail peut être aussi naturel que le jeu ou le repos. Si les conditions sont réunies, c’est même un moyen de se réaliser. L’individu peut faire preuve de créativité, de responsabilité et d’autonomie. Dès lors, le rôle du manageur n’est plus de contrôler mais de favoriser la participation, la reconnaissance et le développement personnel.
Ainsi McGregor nous apprend que la motivation dépend du regard porté sur l’humain. Un management fondé sur la méfiance (théorie X) crée de la passivité et du désengagement alors que s’il est fondé sur la confiance (théorie Y), il stimule l’initiative et la coopération.
Cette distinction, bien que simplifiée, reste très actuelle, notamment dans les débats sur le télétravail, les organisations horizontales et le management participatif.
Les années 70 ont vu naître la théorie de l’autodétermination (TAD), due à Edward L. Deci et Richard Ryan. Ces derniers ont publié leurs travaux en 1985. Ils distinguent la motivation extrinsèque (agir pour obtenir une récompense ou éviter une punition) et la motivation intrinsèque (agir pour le plaisir ou l’intérêt que procure l’activité elle-même).
Les auteurs identifient trois besoins psychologiques fondamentaux :
- Autonomie : se sentir à l’origine de ses actions.
- Compétence : se sentir efficace dans ce qu’on fait.
- Affiliation : se sentir connecté et accepté par les autres.
Lorsque ces besoins sont satisfaits, la motivation devient durable et profonde. C’est pourquoi, par exemple, un enseignant ou un manageur qui favorise l’autonomie et la reconnaissance stimule naturellement la motivation intrinsèque de son groupe.
Causes sociales
Les humains étant des êtres sociaux, leur motivation dépend fortement du regard des autres et des normes du groupe.
- Dans les cultures collectivistes (Extrême-Orient…), la motivation est souvent liée au devoir, à la contribution au groupe, à l’honneur familial…
- Dans les cultures individualistes (occidentale), elle est davantage centrée sur la réussite personnelle ou l’accomplissement individuel. Mais l’appartenance à un groupe (entreprise, équipe, association) peut être un puissant moteur. L’effet de cohésion et la reconnaissance sociale renforcent la persistance dans l’effort.

La théorie de l’équité d’Adams (1963) explique que les individus comparent constamment leurs contributions et leurs récompenses à celles des autres. Si un salarié perçoit une injustice (par exemple, un collègue mieux payé pour le même travail), sa motivation chute et peut même se transformer en démotivation ou en retrait.
Par conséquent, les récompenses ne suffisent pas. Elles doivent aussi être perçues comme équitables.
Comment le management peut-il intégrer les ressorts de la motivation ? Plusieurs modèles existent.
Le modèle de Vroom (1964) ou théorie des attentes : Motivation = Attente × Instrumentalité × Valence. Autrement dit, une personne est motivée si :
- elle croit que ses efforts peuvent produire des résultats (attente)
- elle pense que ces résultats seront récompensés (instrumentalité)
- elle accorde de la valeur à la récompense (valence).
La théorie du renforcement de Skinner (1953) stipule que la motivation est fonction des conséquences des actions. Un comportement récompensé sera répété, un comportement puni sera évité. C’est une approche comportementaliste, présente dans les systèmes de primes et d’évaluations.
Selon le modèle de Hackman et Oldham (1976), la motivation au travail dépend de cinq dimensions du poste : variété des tâches, autonomie, signification, feedback et identité de la tâche. Un travail jugé significatif et autonome est naturellement plus motivant.
Ces théories peuvent être mises en rapport avec les styles de management.
Nouvelles formes de travail
Aujourd’hui, de nouvelles aspirations sont apparues ou se sont développées : télétravail, quête de sens, équilibre entre vie professionnelle et vie privée…
La motivation ne passe plus seulement par la rémunération ou le prestige, mais par des éléments plus existentiels : autonomie, utilité sociale, reconnaissance, développement personnel. Les entreprises qui négligent ces leviers se heurtent au désengagement d’une partie des salariés.