Introduction à la comptabilité
Derrière ses colonnes de chiffres, la comptabilité raconte une histoire : celle des flux d’argent, de biens, de dettes, de créances, bref… de tout ce qui fait vivre une organisation. Surtout, elle n’est pas qu’une contrainte administrative pour faire plaisir au fisc : les données comptables permettent le pilotage.
Nous présentons ci-dessous quelques notions fondamentales de comptabilité générale (ou financière). Le niveau est celui d’une terminale STMG (enseignement spécifique de gestion et finance).
Quelques définitions
1- Les flux et les stocks
Imaginez un film. Les flux sont les mouvements : entrées et sorties d’argent, de marchandises, de services… Ce sont des événements qui changent l’état des choses dans l’entreprise. Exemple : encaisser un paiement.
Maintenant, mettez le film sur pause. Ce qui est figé à l’écran à un instant donné, ce sont des stocks (au sens comptable) : solde du compte bancaire, somme d’argent à devoir aux fournisseur, quantité de marchandises en entrepôt (et là, ce sont les « stocks » au sens plus habituel !).
Les flux modifient les stocks. La comptabilité observe les deux.
2- Les créances et les dettes
La créance est ce que les autres nous doivent. Quand on vend à crédit, le client ne paie pas tout de suite. L’argent que l’on doit recevoir est une créance.
À l’inverse, la dette est ce que l’on doit (à un fournisseur, à la banque, au fisc…).
Autrement dit, les créances représentent de l’argent qui rentrera et les dettes de l’argent qui sortira.
3- L’actif et le passif
L’actif est tout ce que l’entreprise possède ou ce qui lui est dû (biens, stocks, créances, liquidités…). C’est le « patrimoine positif ».
Le passif représente toutes les ressources financières de l’entreprise, y compris ce qu’elle doit à autrui. Exemples : emprunts bancaire, capital apporté par les associés…
L’actif est donc « ce que nous pouvons utiliser » et le passif est « d’où vient l’argent pour l’obtenir ». Ces notions sont davantage expliquées en page de bilan.
4- Les charges et les produits
Une charge constate un appauvrissement pour l’entreprise. Par exemple : payer un loyer, acheter des matières premières, constater un amortissement…
Au contraire, un produit est un enrichissement. Exemples : vendre des marchandises, percevoir un loyer, toucher une subvention…
Charges et produits ne sont pas des flux de trésorerie immédiate. C’est la date de comptabilisation qui importe. Ces notions sont plus détaillées en page de comptes annuels.
Plan comptable français
Un compte est un peu comme une boîte dans laquelle on range toutes les opérations qui concernent la même chose. Par exemple, dans une « boîte banque », on y met toutes les entrées et sorties d’argent du compte bancaire.
Le plan comptable est un système de classement normalisé de tous les comptes. Il définit leur organisation, leur numérotation et leurs règles d’utilisation, afin d’uniformiser la tenue des comptabilités et de faciliter la lecture des états financiers.
En France, le premier plan comptable général (PCG) date de 1947. De révision en révision, plusieurs se sont succédés. Le dernier est celui de 2025.
https://www.l-expert-comptable.com/plan-comptable
Le PCG n’est pas universel. Dans le monde, il existe notamment la norme IFRS (International Financial Reporting Standards), obligatoire pour les groupes cotés en bourse. Progressivement, le PCG tend à s’en rapprocher.
Une entreprise tient obligatoirement une comptabilité générale. Une autre comptabilité, dite analytique ou de gestion, est facultative. Non normalisée, elle sert aux besoins internes, par exemple pour déterminer les coûts. Ainsi, il n’existe qu’un compte fournisseur en comptabilité générale mais en analytique, le contrôleur de gestion peur choisir de créer autant de comptes qu’il y a de fournisseurs.
Comptabilité en partie double
La partie double est la méthode universelle pour enregistrer les opérations.
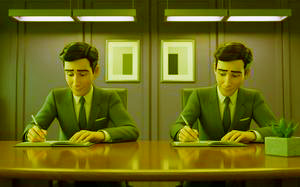
Chaque opération affecte au moins deux comptes. Ce qui est débité dans un compte est crédité dans un autre, pour le même montant. Donc, le total des débits est égal au total des crédits.
Exemple. Supposons que l’entreprise achète pour 500 € HT de marchandises, payées par virement bancaire (TVA \(20\%\)). À la réception de la facture :
- Le compte 607 (Achats de marchandises) est débité de 500.
- Le compte 44566 (TVA déductible) est débité de 100.
- Le compte 512 (Banque) est crédité de 600.
Cette méthode garantit la fiabilité (un enregistrement déséquilibré se repère immédiatement), permet de tracer toutes les opérations et facilite la préparation des états financiers (bilan, compte de résultat...).
Documents comptables
Les pièces justificatives sont les preuves des opérations : factures, relevés bancaires, contrats, notes de frais… La règle est qu’aucune écriture comptable ne doit exister sans pièce justificative.
Le journal est le « livre » des opérations. Chaque écriture y figure par ordre chronologique, avec les informations suivantes :
- Date
- Numéro de pièce
- Comptes débités et crédités
- Montants
- Libellé
Exemple :
01/04/2025 – Facture achat marchandises – 607 D 500 / 44566 D 100 / 512 C 600
Le grand livre regroupe les écritures par compte. On y voit toutes les opérations passées dans un compte précis, ce qui facilite le suivi et le contrôle.
La balance récapitule :
- Le solde initial de chaque compte
- Le total des mouvements débit et crédit
- Le solde final.
En débit de leurs appellations, il est évident que ces états sont aujourd’hui dématérialisés. Ils sont disponibles avec des logiciels et très souvent, à partir d’une certaine taille d’entreprise, par des ERP.
À la fin de l’exercice, toutes ces données sont consolidées en documents de synthèse :
- Compte de résultat : c’est la synthèse des charges et produits de l’exercice. Il permet de calculer le résultat (bénéfice ou perte).
- Bilan : c’est une photo du patrimoine (actif et passif) à une date donnée. Il est obligatoire à la date de fin d’exercice.
- Annexes : ce sont des explications complémentaires. Elles permettent de comprendre les montants des deux documents précédents.
Intégration dans le processus de gestion
La comptabilité ne vit pas seule dans sa bulle. Elle s’intègre dans les processus de gestion.
- Processus de planification : prévoir les budgets, les ressources.
- Exécution : achats, ventes, paiements, encaissements.
- Enregistrement : comptabilisation des opérations avec pièces justificatives.
- Analyse : traitement des états financiers pour décider.
- Ajustement : corriger la stratégie en fonction des résultats.
